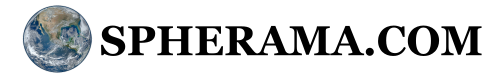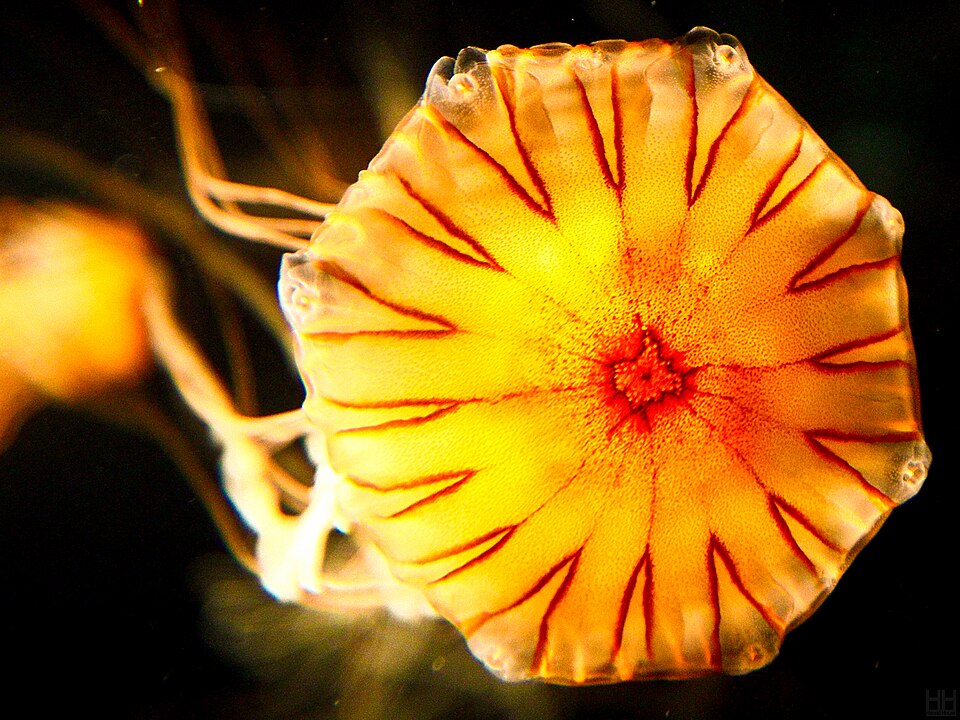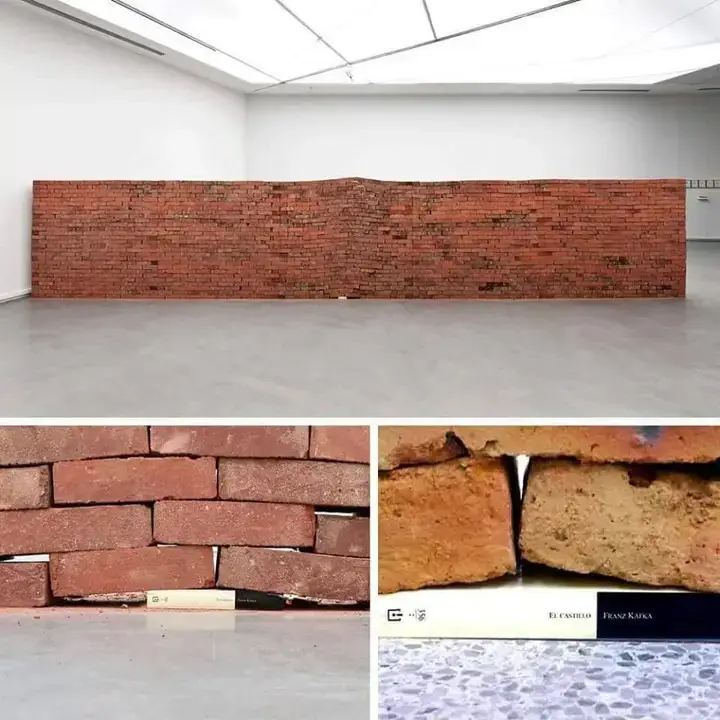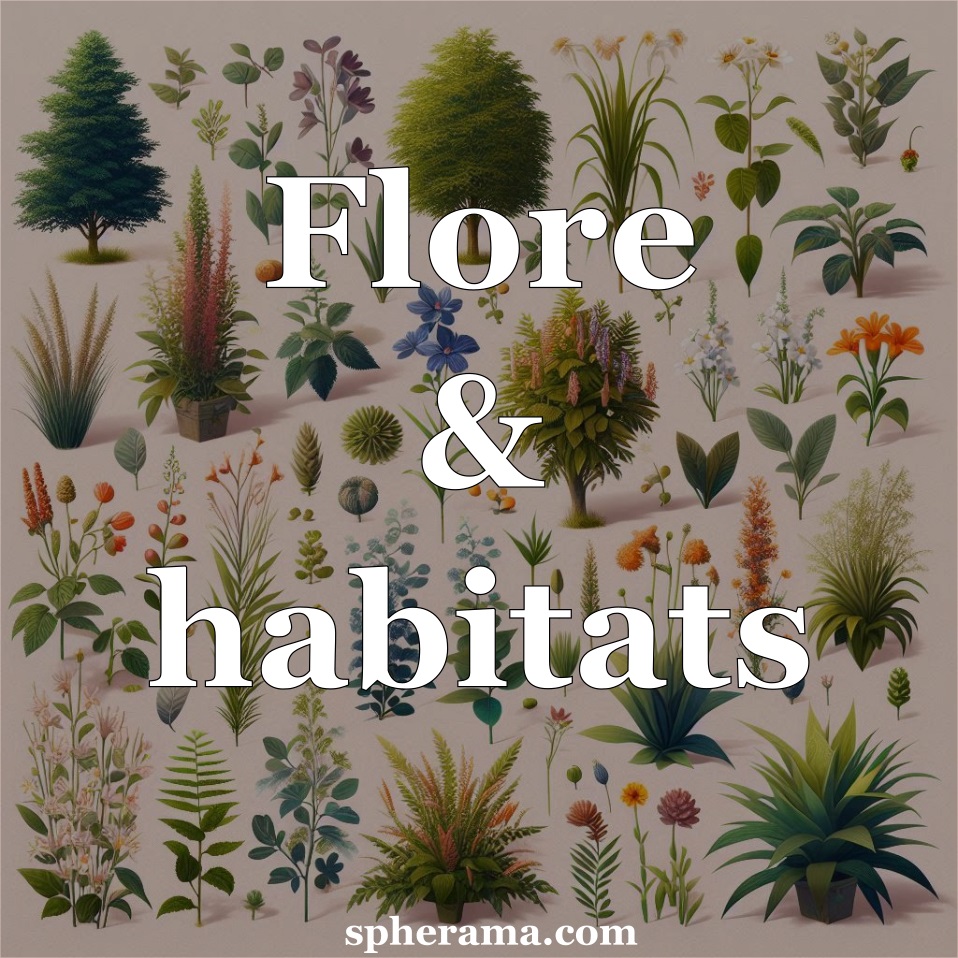Explorez les écosystèmes et habitats naturels remarquables de la flore mondiale, avec des articles sur les plantes, la botanique et la biodiversité.
Lire plusHydnellum peckii : Le champignon à l'apparence sanguine
Hydnellum peckii, également connu sous le nom de « champignon dentelé saignant » ou « champignon fraise et crème », est une espèce fongique appartenant à la famille des Bankeraceae. Ce champignon mycorhizien, principalement présent dans les forêts tempérées de l’hémisphère nord, est reconnaissable à son aspect inhabituel : un chapeau blanchâtre ou brunâtre exsudant un liquide rouge vif, riche en pigments et en composés bioactifs. Bien que non toxique, H. peckii est considéré comme immangeable en raison de sa texture coriace et de son goût extrêmement amer.
L’une des particularités les plus fascinantes de Hydnellum peckii réside dans son apparence évoquant des gouttes de sang perlées à la surface de son chapeau. Ce phénomène, appelé guttation, est dû à l’excrétion de pigments et de fluides contenant des composés bioactifs aux propriétés antibactériennes et anticoagulantes. Cette caractéristique lui a valu divers surnoms évocateurs, tels que « champignon du diable » ou « dent saignante », renforçant ainsi son image intrigante et parfois inquiétante dans l’imaginaire collectif.
Description, habitat et surnoms fascinants de Hydnellum peckii
Hydnellum peckii, membre de la famille des Bankeraceae, est un champignon basidiomycète facilement reconnaissable à son apparence saisissante. Son chapeau irrégulier, initialement blanchâtre, se teinte progressivement de brun à maturité et présente une surface bosselée ou feutrée. Lorsqu’il est jeune, il exsude un liquide rouge vif à partir de pores microscopiques, un phénomène appelé guttation, qui lui confère son aspect caractéristique évoquant des gouttes de sang. Son hyménium, situé sous le chapeau, est composé de structures dentelées plutôt que de lames ou de pores, ce qui le classe parmi les champignons dits « hydnoïdes ». Le stipe, court et robuste, adopte des teintes brunâtres à rougeâtres avec l’âge. Son goût est notoirement amer, et sa texture ligneuse le rend impropre à la consommation.
Son nom spécifique, peckii, lui a été attribué en hommage au mycologue américain Charles Horton Peck, qui a contribué à sa description scientifique au XIXe siècle. Parmi ses surnoms évocateurs, on trouve « dent saignante » ou encore « champignon du diable ».

Vue rapprochée d’un Hydnellum peckii jeune, dont la surface exsude un liquide rouge vif, rappelant une goutte de sang sur le chapeau. | © Claude-Alain Berdoz
Hydnellum peckii se rencontre principalement dans les forêts tempérées de l’hémisphère nord, notamment en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Il établit une relation mycorhizienne avec diverses essences d’arbres, en particulier les conifères tels que les pins et les sapins, contribuant ainsi à l’absorption des nutriments et à la santé des sols forestiers. Il pousse généralement sur des sols acides, riches en matière organique, et apprécie les environnements humides et ombragés. On l’observe le plus souvent en été et en automne, parfois en groupes dispersés au pied des arbres.
Cycle de vie et stratégie de survie de Hydnellum peckii
Hydnellum peckii est un champignon mycorhizien, ce qui signifie qu’il établit une relation symbiotique avec les racines des arbres, en particulier les conifères. Grâce à cette association, il échange des nutriments : il fournit à l’arbre de l’eau et des minéraux essentiels, tandis qu’il reçoit en retour des sucres issus de la photosynthèse. Contrairement aux champignons saprophytes, qui décomposent la matière organique morte, H. peckii dépend donc de la présence d’arbres vivants pour se développer. Poussant souvent en groupes dispersés sur le sol forestier, la capacité de H. peckii à exsuder un liquide pigmenté pourrait également jouer un rôle dans la protection contre certaines bactéries ou herbivores fongivores.

Hydnellum peckii dépend de ces habitats riches en biodiversité, gravement menacés par la déforestation. | © Romano Da Mozzio
Le cycle de vie de Hydnellum peckii commence par la libération de spores basidiosporiques, transportées par le vent ou l’eau vers un nouvel environnement propice. Lorsqu’elles atterrissent sur un sol adéquat et rencontrent un partenaire compatible, elles germent pour former un mycélium, un réseau de filaments souterrains qui explore le sol à la recherche de racines d’arbres avec lesquelles s’associer. Une fois la symbiose établie, le champignon peut croître et, sous des conditions favorables (humidité élevée, températures modérées), développer son corps fructifère – la partie visible qui produit de nouvelles spores. À mesure que le champignon vieillit, il prend une teinte brunâtre et cesse progressivement de produire ses exsudats rouges.
Rôle écologique et les défis de conservation de Hydnellum peckii
Hydnellum peckii joue un rôle essentiel dans les écosystèmes forestiers grâce à sa relation mycorhizienne avec les arbres, en particulier les conifères. En formant un réseau souterrain de mycélium, il améliore l’absorption des nutriments minéraux et de l’eau par ses arbres hôtes, contribuant ainsi à leur croissance et à leur résilience face aux stress environnementaux. En retour, il bénéficie des sucres produits par la photosynthèse des arbres. De plus, le mycélium de H. peckii favorise la structuration des sols forestiers et joue un rôle dans le recyclage des nutriments, ce qui participe à la santé globale de l’écosystème. Son exsudat rouge contient des composés aux propriétés antimicrobiennes, ce qui pourrait influencer la compétition avec d’autres micro-organismes du sol. En tant qu’indicateur de forêts matures et non perturbées, sa présence témoigne d’un écosystème forestier en bonne santé.

Photographie du Hydnellum peckii en plein développement, montrant des taches rouges vives sur une surface blanche qui se transforme en un rouge plus intense à mesure que le champignon mûrit. Cette transformation spectaculaire en fait un sujet fascinant pour les mycologues. | © Claude-Alain Berdoz
N'étant actuellement pas classé parmi les espèces menacées, Hydnellum peckii fait toutefois face à des menaces indirectes liées à la déforestation, à l’urbanisation et aux changements climatiques, qui altèrent ses habitats naturels. La raréfaction des forêts de conifères et la modification des sols forestiers pourraient réduire ses populations à long terme. Certaines régions d’Europe ont signalé un déclin de sa présence, ce qui a conduit à son inscription sur des listes rouges régionales en tant qu’espèce rare ou vulnérable.
La conservation des forêts primaires et la limitation de l’exploitation forestière intensive sont essentielles pour préserver H. peckii et les nombreuses espèces qui dépendent des interactions mycorhiziennes. Des initiatives locales de protection des forêts anciennes et une gestion durable des espaces boisés contribuent ainsi à la préservation de cette espèce fongique et de son rôle écologique crucial.
Intérêt culturel, esthétique et potentiel scientifique de Hydnellum peckii
Non comestible en raison de son goût extrêmement amer et de sa texture ligneuse, Hydnellum peckii suscite cependant un intérêt particulier auprès des mycologues et des passionnés de nature en raison de son apparence spectaculaire. Son exsudat rougeâtre, semblable à des goûtes de sang, lui ont valu une réputation intrigante, voire inquiétante, dans certaines cultures. Dans le folklore populaire, il est parfois associé à des légendes macabres ou à des symboles de poison, bien que rien n’indique qu’il soit toxique pour l’Homme. Certains artistes et photographes s’intéressent à lui pour son esthétique unique, et il figure régulièrement dans des expositions ou publications dédiées aux champignons insolites.

Détail des glandes excrétoires du Hydnellum peckii, dégageant un liquide rouge brillant. Ce phénomène, où le champignon semble saigner, est l'une des caractéristiques les plus distinctives de cette espèce rare et intrigante. | © grynetvalp
Sur le plan scientifique, H. peckii attire l’attention des chercheurs pour ses propriétés biochimiques prometteuses. L’exsudat rougeâtre contient des pigments naturels, dont l’atromentine, une molécule aux effets antibactériens et anticoagulants similaires à ceux de l’héparine. Des études préliminaires suggèrent également un potentiel antioxydant et cytotoxique, ouvrant des perspectives en recherche médicale. Toutefois, ces propriétés demeurent peu exploitées à ce jour, et des études plus approfondies sont nécessaires pour en évaluer les applications concrètes. Enfin, comme d’autres champignons mycorhiziens, H. peckii pourrait avoir un rôle indirect dans l’amélioration de la santé des forêts en favorisant la croissance des arbres, un aspect qui intéresse les spécialistes de la foresterie et de la conservation des écosystèmes.

Hydnellum peckii en maturité, sa surface riche en pigments rouges semblant sanglante. | © Claude PAGE
Hydnellum peckii est un champignon fascinant, aussi bien par son apparence singulière que par son rôle écologique essentiel dans les forêts tempérées. Cependant, comme de nombreuses espèces fongiques, il est vulnérable aux modifications de son habitat, soulignant l'importance de préserver les forêts anciennes où il prospère. À la croisée de l’étrange et du scientifique, tout en suscitant un intérêt croissant, H. peckii demeure un exemple remarquable de la diversité et de la complexité du règne fongique, rappelant que même les organismes les plus discrets peuvent jouer un rôle vital dans l’équilibre de la nature.
Ressources bibliographiques :
- H.J. Banker, “Type studies in the Hydnaceae: V. The genus Hydnellum”, Mycologia, vol. 5, no. 4, 1913, pp. 194–205.
- J.M. Khanna, M.H. Malone, K.L. Euler, and L.R. Brady, “Atromentin – anticoagulant from Hydnellum diabolus”, Journal of Pharmaceutical Sciences, vol. 54, no. 7, 1965, pp. 1016–20.
- D. Hall et D.E. Stuntz, “Pileate Hydnaceae of the Puget Sound area III. Brown-spored genus: Hydnellum”, Mycologia, vol. 64, no. 3, 1972, pp. 560–90.
- R. Doll, “Distribution of the stipitate Hydnaceae and the appearance of Hericium creolophus, Cirrhatus spongipellis, Pachyodon and Sistotrema confluens in Mecklenburg, East Germany”, Feddes Repertorium (in German), vol. 90, no. 1–2, 1979, pp. 103–120.
- J. Breitenbach et F. Kranzlin (Société de Mycologie de Lucerne), Dr. Jean Keller (traduction française), “Champignons de Suisse, Contribution à la connaissance de la flore fongique de Suisse - Tome 2 - Champignons sans lames - Hétérobasidiomycètes, Aphyllophorales, Gastéromycètes”, Edition Mykologia Lucerne, Lucerne, 1995.
- V.S. Evenson, Mushrooms of Colorado and the Southern Rocky Mountains, Westcliffe Publishers, 1997.
- D. Parfitt, A.M. Ainsworth, D. Simpson, H.J. Rogers, and L. Boddy, “Molecular and morphological discrimination of stipitate hydnoids in the genera Hydnellum and Phellodon”, Mycological Research, vol. 111, no. 7, 2007, pp. 761–77.
- Guillaume Eyssartier et Pierre Roux, “Guide des champignons France et Europe”, Belin, Paris, septembre 2017.
- MycoBank. International Mycological Association URL