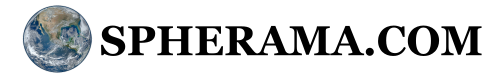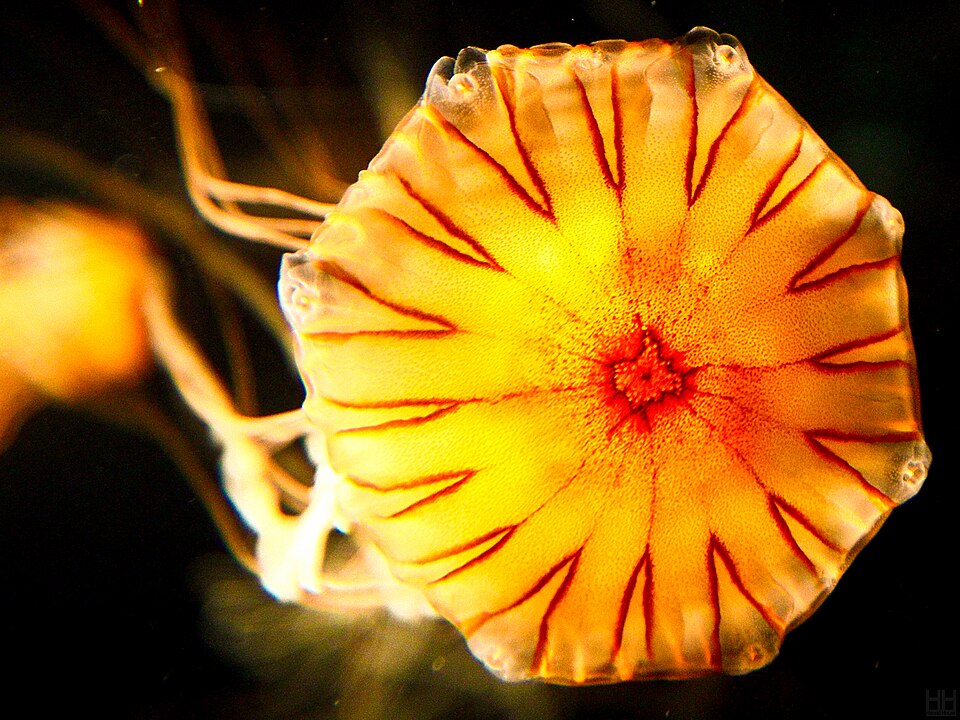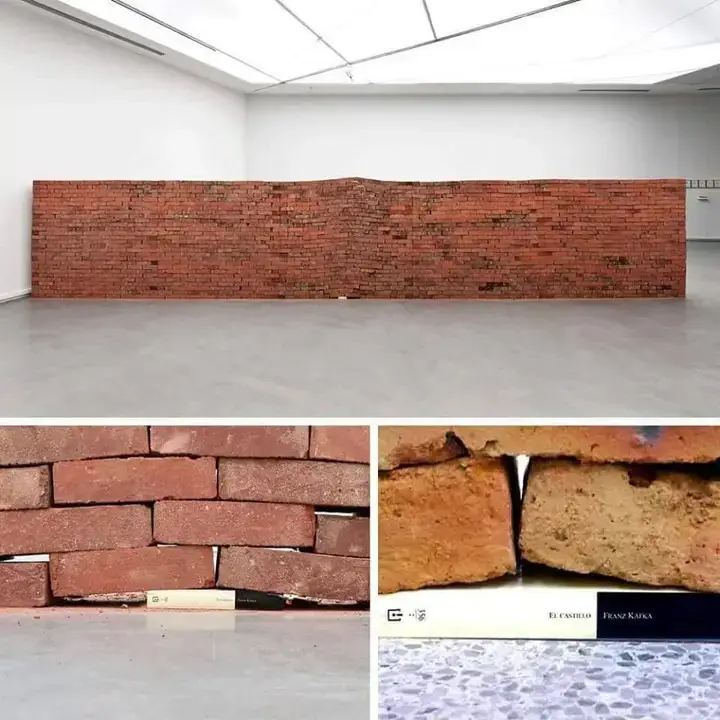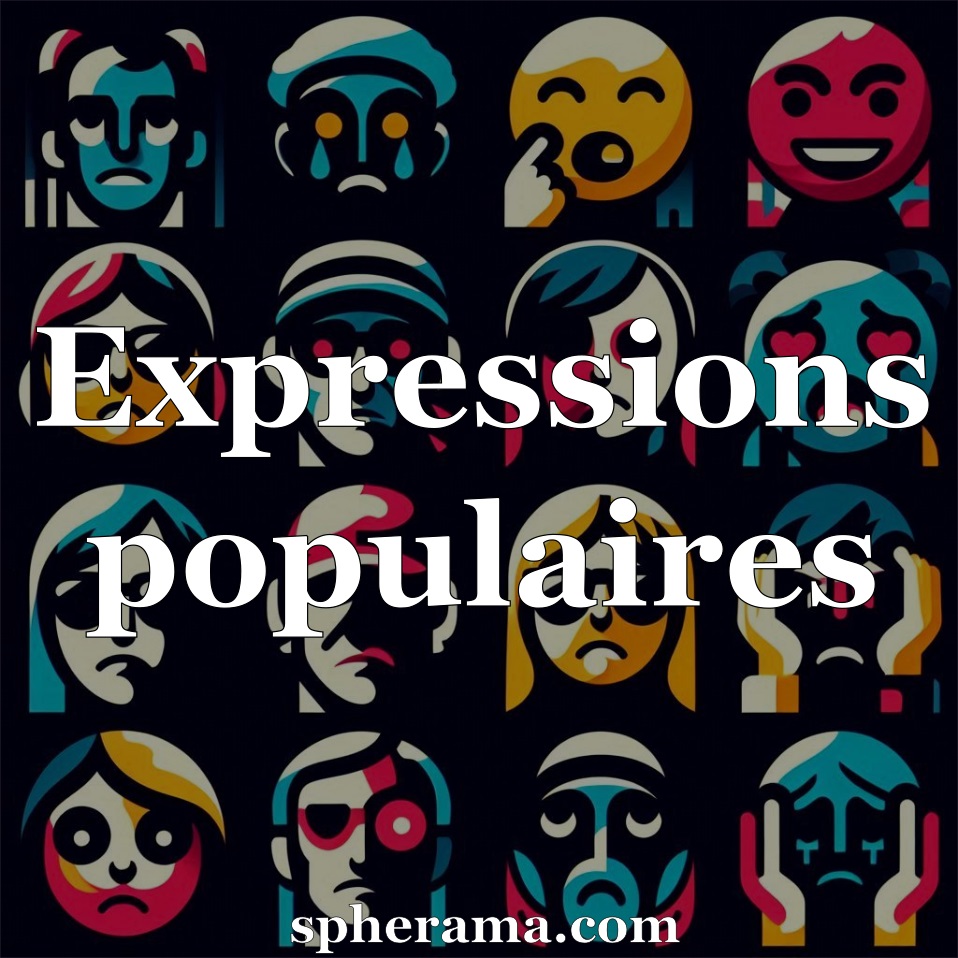Explorez les expressions populaires avec des articles détaillant leur définition, signification, origine et étymologie.
Lire plusExpression : faire l’école buissonnière (définition, signification, origine, étymologie)
Définition et signification de l'expression faire l’école buissonnière
- Manquer volontairement l’école pour se livrer à d’autres occupations.
- Par extension : s’absenter de son travail ou de toute activité obligatoire.
L’expression « faire l’école buissonnière » signifie, au sens figuré, délaisser ses obligations, en particulier scolaires, pour s’adonner à des activités jugées plus plaisantes ou personnelles. Dans son usage contemporain, elle évoque souvent une attitude insouciante ou rebelle, associée à l’enfance et à l’adolescence, mais elle peut également s’appliquer au monde adulte, pour désigner une absence volontaire au travail ou à une tâche assignée.
Origine et étymologie de l'expression faire l’école buissonnière
L’histoire de cette locution est plurielle et témoigne de la richesse des interprétations qui ont accompagné son évolution. Dès 1540, le terme buissonnier servait à qualifier ce qui relevait de la campagne, des buissons et des lieux champêtres. L’« école buissonnière » pouvait alors désigner une école située en plein air, dans un cadre rural, ou encore des activités champêtres auxquelles les enfants s’adonnaient en négligeant l’instruction.
Une explication rapportée par le Grand Larousse renvoie à un épisode historique précis : avant la Réforme, les petites écoles primaires, dépendantes de l’Église de Paris, dispensaient un enseignement sous la direction de chantres catholiques. Pour soustraire leurs enfants à cette influence, les Réformés organisèrent clandestinement des cours en plein air, derrière des haies et des buissons. Ces établissements furent interdits par un arrêt du Parlement en 1554, qui les qualifia d’« écoles buissonnières » en raison du lieu où elles se tenaient.
Parallèlement, d’autres hypothèses ont circulé. L’une d’elles, relayée par Clément Marot au XVIIIᵉ siècle, attribue l’origine de l’expression au concile de Pavie de 1423 : les prélats, effrayés par une épidémie de peste, auraient refusé de s’y rendre, et l’« école de Pavie » aurait alors été dite « buissonnière ». Toutefois, cette explication apparaît davantage comme une réinterprétation tardive que comme une véritable source étymologique.
Une autre piste, attestée dès le XVIIᵉ siècle, explique que l’« école buissonnière » désignait une école si peu fréquentée que les ronces et les buissons avaient envahi les lieux. Enfin, l’interprétation la plus plausible reste celle des chemins creux et buissons qui servaient de refuge aux enfants fuyant l’école. Le qualificatif buissonnier, entendu comme « qui aime la campagne » ou « qui se rapporte aux buissons », rejoint ainsi l’idée de jeunes campagnards préférant aller jouer ou, plus fréquemment encore, aider leurs parents aux travaux agricoles, plutôt que d’assister aux cours.
Usage contemporain et extension du sens de l'expression faire l’école buissonnière
De nos jours, « faire l’école buissonnière » conserve son acception première liée à l’absentéisme scolaire volontaire, mais son emploi s’est élargi à d’autres contextes. On l’utilise pour évoquer toute absence volontaire, qu’elle soit professionnelle, sociale ou même symbolique.
La locution véhicule une connotation souvent légère, empreinte d’une idée de liberté, d’insouciance, voire de résistance aux contraintes institutionnelles. Toutefois, selon le contexte, elle peut également revêtir une nuance critique, lorsqu’elle désigne une négligence ou un manque de sérieux.
Ainsi, l’expression « faire l’école buissonnière » illustre à la fois une pratique populaire enracinée dans l’histoire scolaire et religieuse, et une métaphore durable de l’évasion hors des cadres imposés, encore vivace dans l’imaginaire collectif.