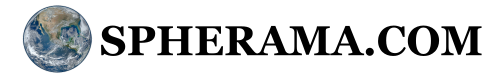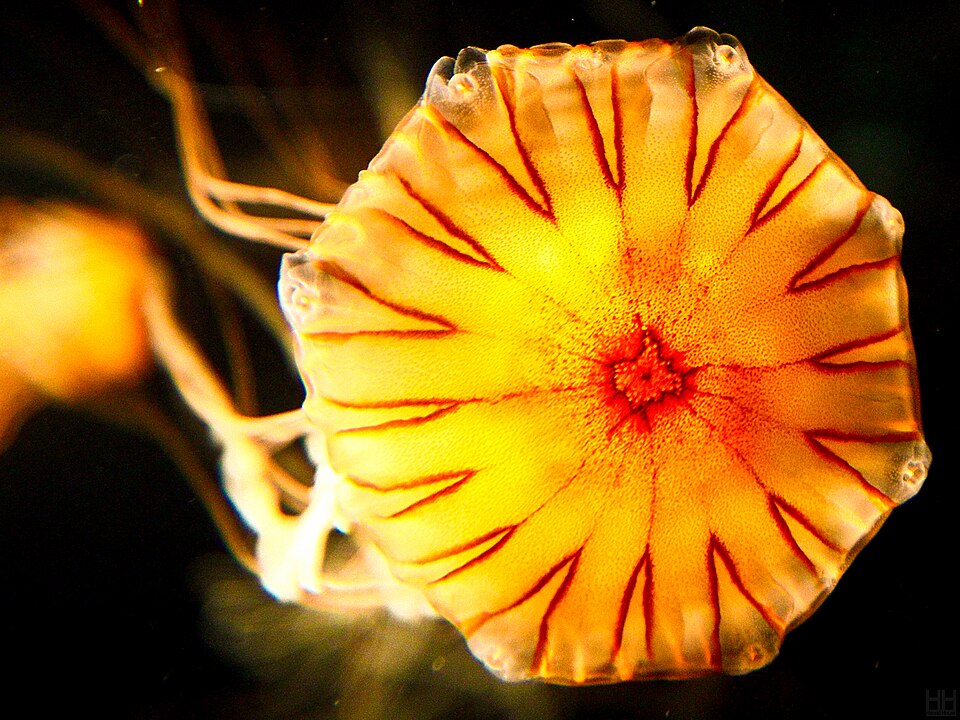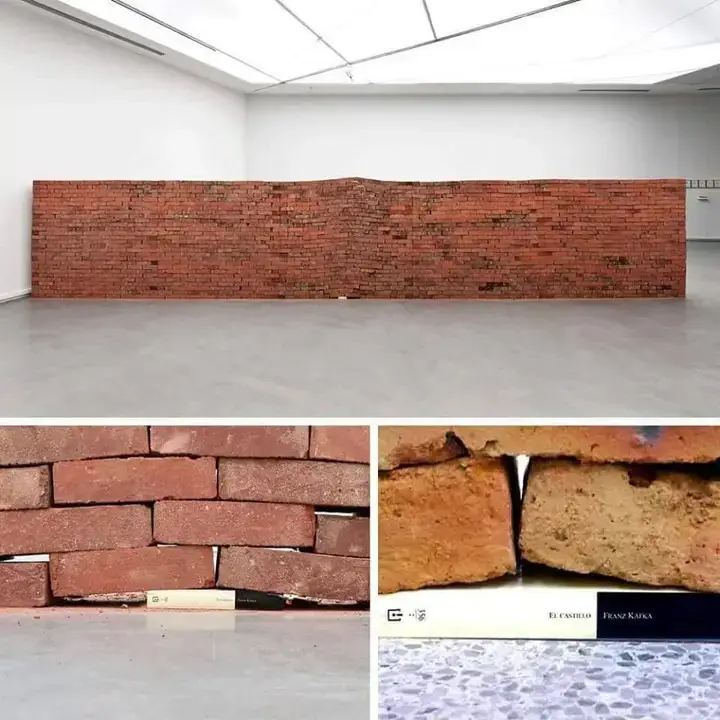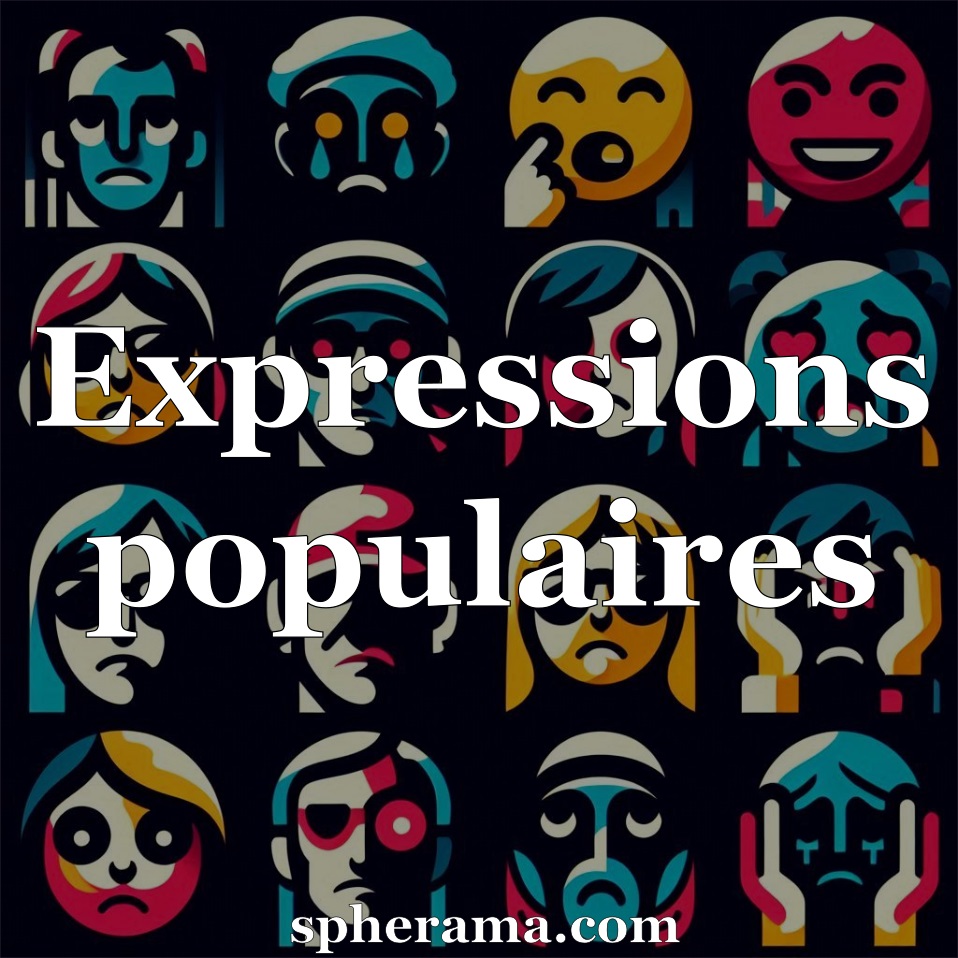Explorez les expressions populaires avec des articles détaillant leur définition, signification, origine et étymologie.
Lire plusExpression : le dindon de la farce (définition, signification, origine, étymologie)
Définition et signification de l'expression le dindon de la farce
- La victime d’une tromperie, d’une moquerie, ou d’un stratagème.
- Une personne qui, dupée ou ridiculisée, devient la risée des autres.
Au sens figuré, l’expression « être le dindon de la farce » désigne un individu abusé, berné ou tourné en dérision, qui se trouve au final perdant dans une situation donnée. Elle s’emploie dans un contexte où une personne subit un tort, une moquerie ou un désavantage, généralement au profit des autres, et souvent de manière comique ou humiliante.
Origine et étymologie de l'expression le dindon de la farce
L’origine de la locution « être le dindon de la farce » a fait l’objet de plusieurs hypothèses. Trois explications principales ont été avancées, mais leur crédibilité varie selon les sources historiques et linguistiques :
a) L’hypothèse médiévale : les farces théâtrales
Dès le Moyen Âge, les farces constituaient des intermèdes comiques intégrés aux représentations théâtrales. Ces pièces mettaient en scène des personnages types, tels que des pères crédules et dupés par des enfants irrévérencieux. On aurait surnommé ces personnages les « pères dindons », symboles de naïveté et de duperie. Toutefois, cette explication soulève une difficulté chronologique : le dindon, oiseau originaire d’Amérique, n’a été introduit en Europe qu’au XVIᵉ siècle, bien après l’essor des farces médiévales. L’anachronisme affaiblit donc cette thèse.
b) L’hypothèse du spectacle forain (XVIIIᵉ – XIXᵉ siècles)
Claude Duneton rapporte qu’à Paris, entre 1739 et 1844, un spectacle forain intitulé Le Ballet des dindons consistait à placer des dindons vivants sur une plaque de métal chauffée. Pour échapper à la brûlure, les oiseaux « dansaient », provoquant le rire cruel des spectateurs. Bien que ce rapprochement associe le dindon au registre comique et à l’idée de farce, le lien direct avec la notion de duperie demeure ténu.
c) L’hypothèse linguistique et culinaire (la plus vraisemblable)
La troisième hypothèse, plus convaincante, repose sur un jeu de mots entre le dindon, oiseau réputé stupide et donc aisément dupé, et la notion de farce au sens culinaire. En argot, « se faire plumer » signifie « se faire duper ». Or, le dindon est littéralement un animal que l’on plume avant de le cuisiner. Dès lors, l’association du dindon avec l’idée de victime trompée s’impose naturellement.
Par ailleurs, le terme dinde, employé depuis longtemps au sens figuré pour désigner une jeune fille niaise, apparaît déjà dans le Dictionnaire de Trévoux (1771). Le passage au masculin (« dindon ») permet alors de désigner tout individu niais, donc prompt à se faire berner. Cette interprétation se trouve confirmée par une citation de Colnet, dans L’Hermite du Faubourg Saint-Germain (1825), où il évoque « les plaideurs et les dindons qui allaient se faire plumer », rapprochant ainsi explicitement le dindon de la duperie.
Enfin, le mot farce ajoute une dimension humoristique et culinaire. Le Dictionnaire des aliments, vins et liqueurs (1750), de François-Alexandre Aubert de La Chesnaye des Bois, atteste déjà l’usage de farcir un dindon pour la préparation culinaire. L’expression « dindon de la farce » associe donc le champ lexical du comique (la farce théâtrale) à celui de la cuisine (la farce alimentaire), ce qui en renforce la portée imagée.
Usage contemporain et extension du sens de l'expression le dindon de la farce
Aujourd’hui, l’expression « être le dindon de la farce » conserve son sens figuré premier : désigner une victime de tromperie ou de moquerie. Elle s’applique aussi bien dans des situations de la vie quotidienne que dans des contextes sociaux, politiques ou professionnels.
Par extension, elle peut revêtir une dimension critique, soulignant l’injustice ou la naïveté d’une personne désavantagée par les manœuvres d’autrui. Ainsi, un salarié lésé par une décision d’entreprise, un électeur trompé par des promesses politiques ou un individu pris dans une supercherie peuvent tous être qualifiés de « dindons de la farce ».
L’expression, à la fois imagée et familière, illustre parfaitement la richesse de la langue française où le registre animalier, le vocabulaire culinaire et le comique théâtral se rejoignent pour produire une métaphore durable et toujours vivante.