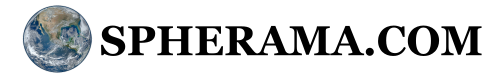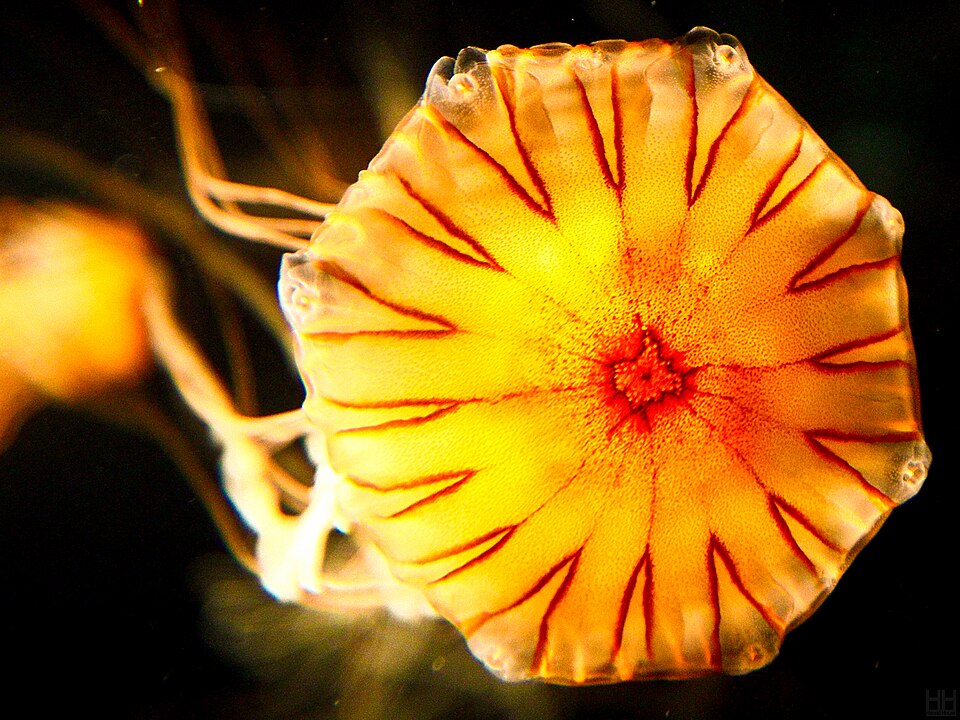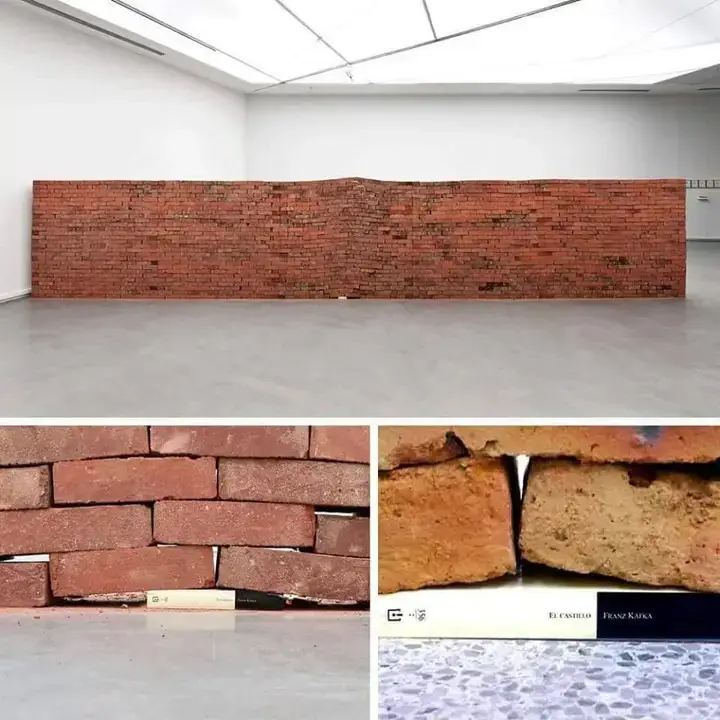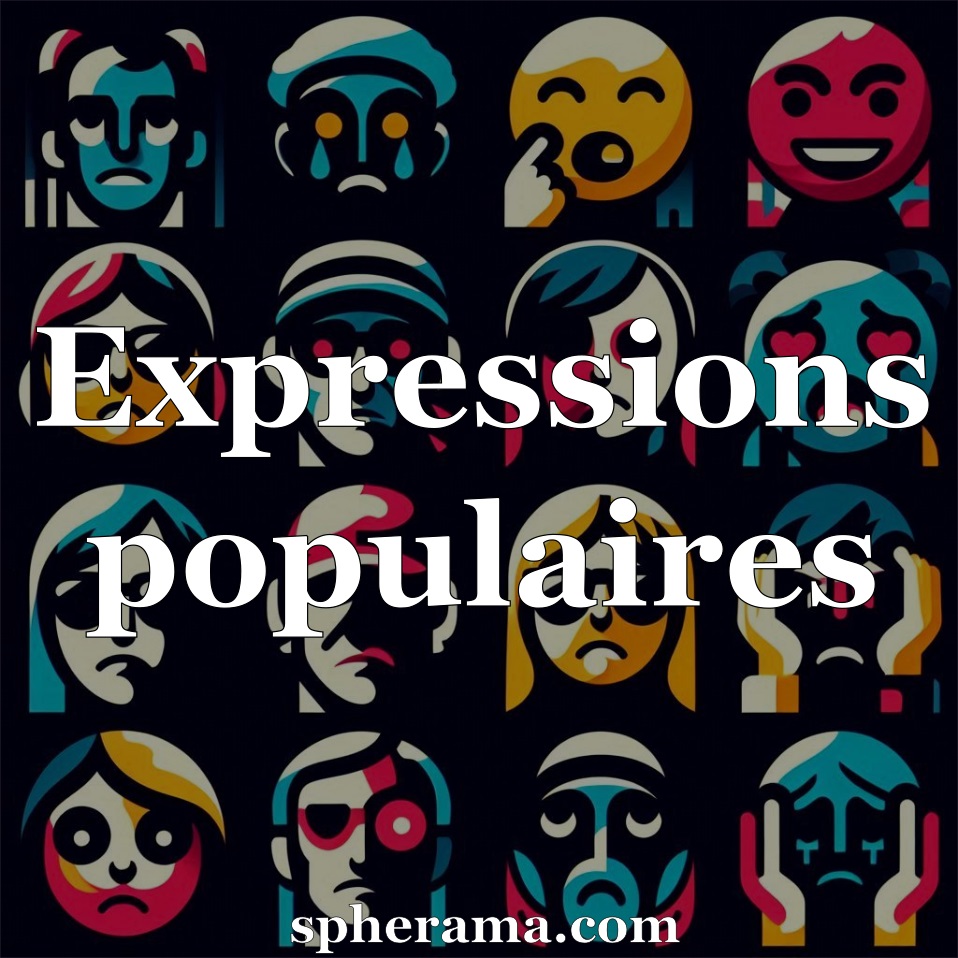Explorez les expressions populaires avec des articles détaillant leur définition, signification, origine et étymologie.
Lire plusExpression : l'argent n’a pas d’odeur (définition, signification, origine, étymologie)
Définition et signification de l'expression l'argent n’a pas d’odeur
- Principe selon lequel la valeur de l'argent reste la même, quelle que soit son origine.
- Idée que l'on peut accepter des gains financiers sans se soucier de leur provenance.
- Expression souvent utilisée pour justifier l'acceptation d'argent issu de sources douteuses ou controversées.
L'expression « l'argent n’a pas d’odeur » signifie que la provenance de l’argent est secondaire par rapport à son utilité ou sa possession. Elle est souvent employée pour désigner des fonds acquis de manière douteuse, mais dont l’origine importe peu tant qu’ils peuvent être utilisés. Plus largement, cette formule illustre une acceptation pragmatique, voire cynique, de la richesse, mettant de côté des considérations éthiques ou morales.
Origine et étymologie de l'expression l'argent n’a pas d’odeur
La locution « l'argent n’a pas d’odeur » trouve son origine dans une anecdote historique impliquant l’empereur romain Vespasien (69-79 après J.-C.). Après le règne dispendieux de Néron, les caisses de l’Empire romain étaient pratiquement vides. Pour renflouer le trésor public, Vespasien introduisit plusieurs taxes, dont une particulièrement remarquée : celle imposée sur les urines.
À cette époque, l’urine humaine était collectée dans des réservoirs pour des usages industriels, notamment par les teinturiers qui l’utilisaient pour dégraisser les peaux ou fixer les teintures. Tous les chefs de famille étaient tenus de payer cette taxe tous les quatre ans, proportionnellement au nombre de personnes et d’animaux vivant sous leur toit.
Face aux moqueries du peuple et aux critiques de son fils Titus, Vespasien aurait répondu de manière éloquente. Selon la tradition, il plaça une pièce de monnaie sous le nez de son fils en lui demandant si elle avait une odeur, déclarant ainsi : « Pecunia non olet » (l’argent n’a pas d’odeur). Par cette remarque, il soulignait que la finalité de l’argent — remplir les caisses de l’État — était plus importante que son origine, aussi peu noble fût-elle.
Usage contemporain et extension du sens l'argent n’a pas d’odeur
Cette anecdote, transmise par les historiens romains comme Suétone, a traversé les siècles et a donné lieu à l’expression actuelle. Elle s’est enrichie de nouveaux usages au fil du temps, notamment avec des termes comme « argent sale », faisant référence aux revenus provenant d’activités illicites. En réponse, des pratiques comme le blanchiment d’argent ont vu le jour, consistant à légitimer ces fonds en effaçant leur origine douteuse.
La formulation l’argent n’a pas d’odeur reflète une tension universelle entre la morale et le pragmatisme économique. Si elle invite à une réflexion sur les compromis éthiques liés à l’acquisition de richesses, elle peut également être interprétée comme une justification cynique de pratiques douteuses.
Enfin, l’héritage de cette taxe particulière de Vespasien s’est prolongé dans le langage, comme en témoigne le terme « vespasienne », désignant les urinoirs publics installés à Paris à partir de 1834. Cet épisode du passé reste ainsi un exemple marquant de l’acceptation historique, voire culturelle, d’une certaine neutralité de l’argent face aux considérations morales.