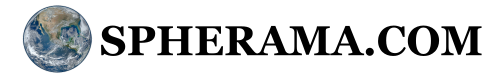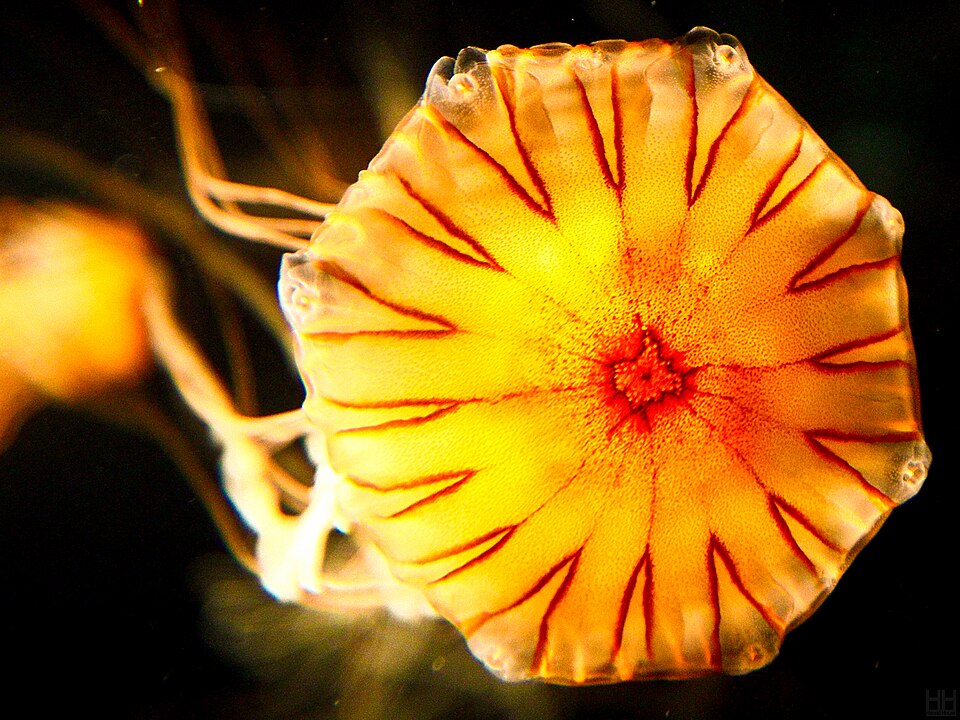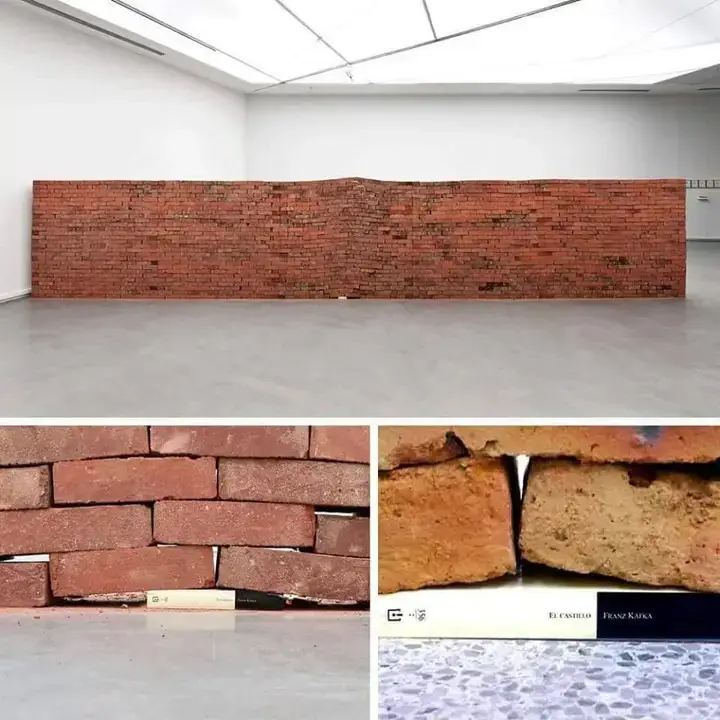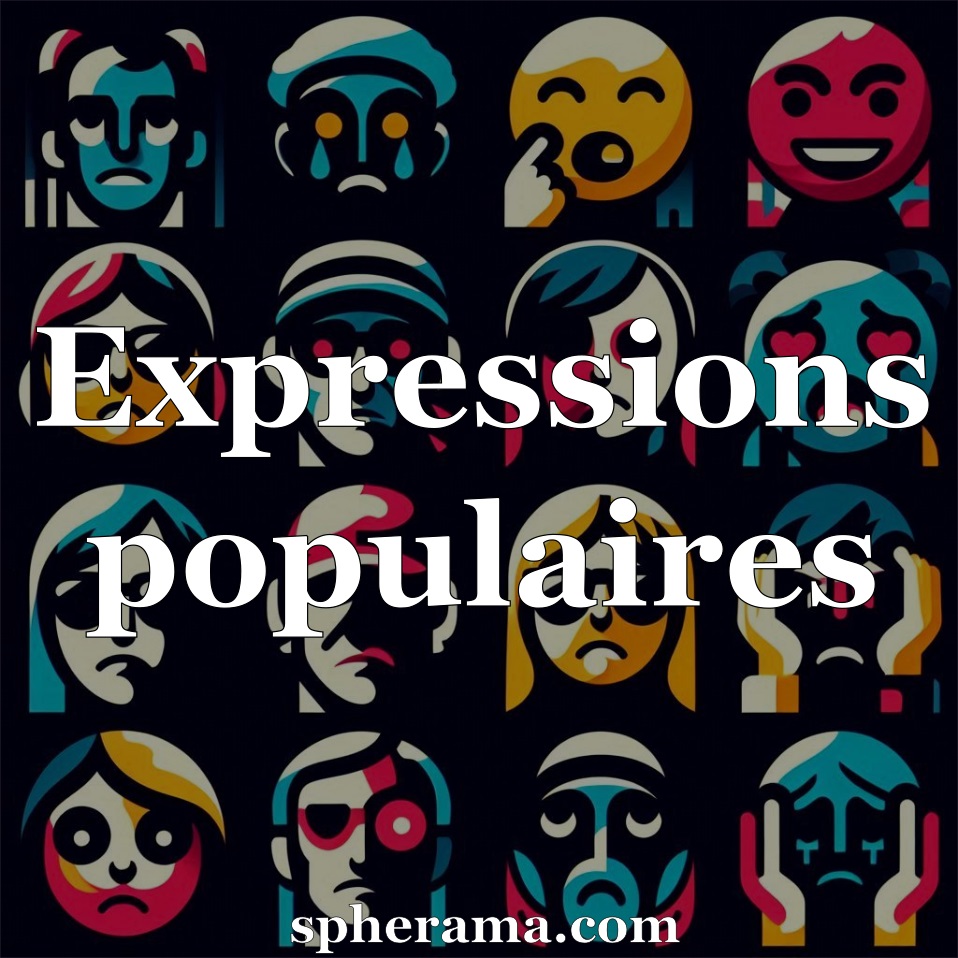Explorez les expressions populaires avec des articles détaillant leur définition, signification, origine et étymologie.
Lire plusExpression : mettre du beurre dans les épinards (définition, signification, origine, étymologie)
Définition et signification de l'expression mettre du beurre dans les épinards
- Améliorer ses conditions de vie.
- Augmenter ses revenus, gagner davantage d’argent.
L’expression « mettre du beurre dans les épinards » s’emploie au sens figuré pour désigner une amélioration, souvent modeste mais appréciable, des conditions matérielles ou financières d’un individu ou d’un ménage. Elle suggère l’idée d’un supplément, d’un confort additionnel apporté à une situation auparavant frugale ou austère. Son usage s’étend dans les domaines du quotidien, notamment pour évoquer un revenu complémentaire, une prime ou un bénéfice économique qui rend la vie plus agréable.
Sur le plan linguistique, cette locution repose sur une métaphore culinaire accessible : les épinards, perçus comme un aliment simple, peu savoureux lorsqu’ils sont consommés nature, deviennent plus appétissants lorsqu’ils sont agrémentés de beurre. L’image renforce ainsi l’idée qu’une amélioration, même minime, peut rehausser sensiblement une situation de départ jugée ordinaire, voire peu attrayante.
Origine et étymologie de l'expression mettre du beurre dans les épinards
L’origine exacte de l’expression n’est pas précisément datée, mais elle émerge dans le langage courant au cours du XXᵉ siècle, dans un contexte où le beurre, denrée à la fois symbolique et économique, incarne une certaine forme de richesse ou de confort. D’un point de vue historique, cette symbolique est liée à la valeur nutritive et économique du beurre, considéré tantôt comme produit de luxe, tantôt comme aliment de substitution selon les époques et les classes sociales.
Plusieurs expressions françaises confirment ce statut valorisé du beurre dans l’imaginaire collectif : « faire son beurre » (s’enrichir) ou encore « avoir le cul dans le beurre » (vivre dans l’aisance), notamment employée dans la francophonie belge. Toutefois, cette valorisation du beurre est relativement récente si l’on considère l’histoire des pratiques alimentaires.
L’historien Jean-Louis Flandrin, spécialiste de l’histoire de l’alimentation, a démontré que le beurre était, au Moyen Âge, davantage consommé par les populations modestes que par les élites. Les livres de cuisine des XIVᵉ et XVᵉ siècles, reflétant les usages des classes aisées, recouraient peu à cette matière grasse, lui préférant d'autres produits comme le saindoux ou les huiles végétales. Ce n’est qu’à partir des XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles que l’emploi du beurre devient plus fréquent, jusqu’à s’imposer comme un marqueur social aux XIXᵉ et XXᵉ siècles.
Par ailleurs, l’Église a également joué un rôle dans la diffusion du beurre, notamment à travers ses interdits alimentaires. Jusqu’au XVᵉ siècle, le beurre était prohibé durant le carême en raison de son origine animale. L’octroi progressif de dispenses ecclésiastiques a favorisé son intégration dans les plats autorisés pendant cette période, notamment ceux à base de légumes ou de poissons. Cette évolution a contribué à la normalisation de l’usage du beurre dans la cuisine quotidienne.
3) Usage contemporain et extension du sens de l'expression mettre du beurre dans les épinards
De nos jours, la locution mettre du beurre dans les épinards conserve son sens figuré d’origine, mais elle s’emploie de façon plus généralisée pour évoquer tout type d’amélioration des conditions de vie, quelle qu’en soit la source : prime, revenu supplémentaire, avantage ponctuel. Elle est souvent utilisée dans des contextes économiques ou professionnels pour souligner l’impact positif d’un complément financier, même limité, sur le quotidien.
Si l’expression garde une tonalité légère, elle n’est pas dénuée de portée sociale : elle témoigne d’une époque où les marges de confort sont parfois rares et où chaque amélioration, si modeste soit-elle, est perçue comme un bénéfice notable.