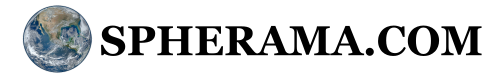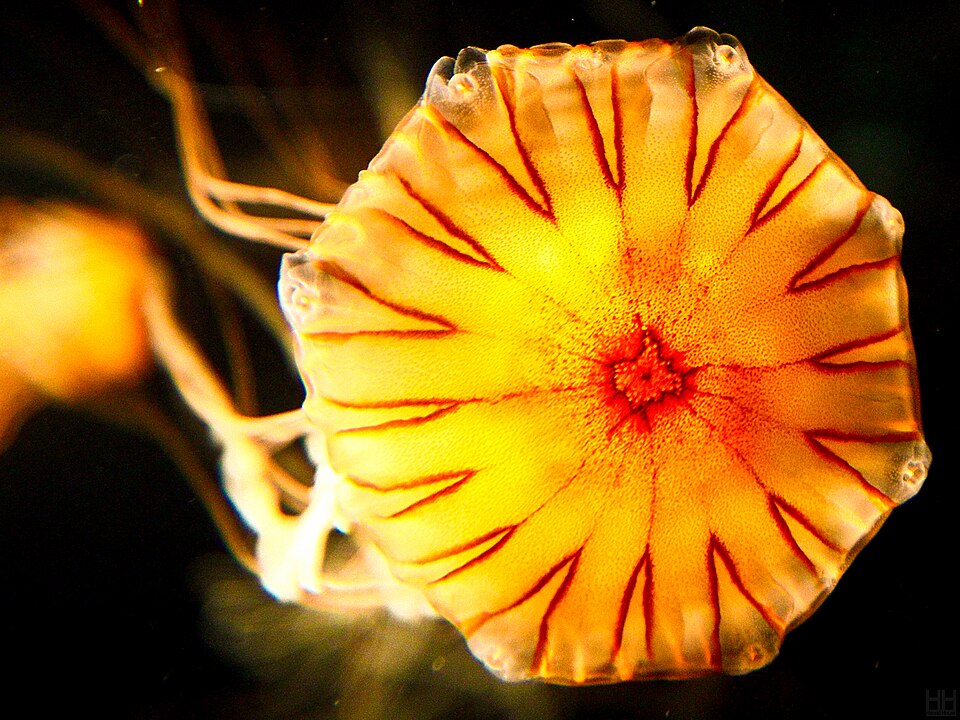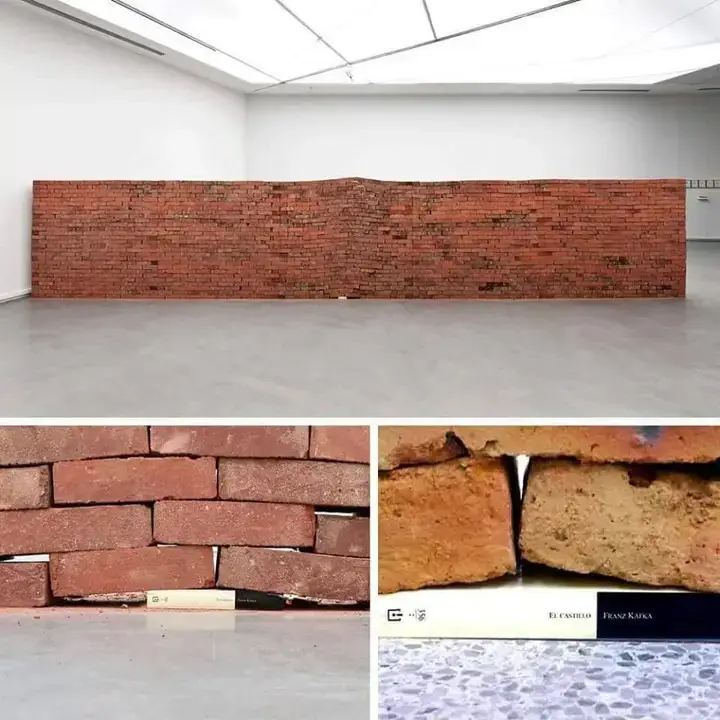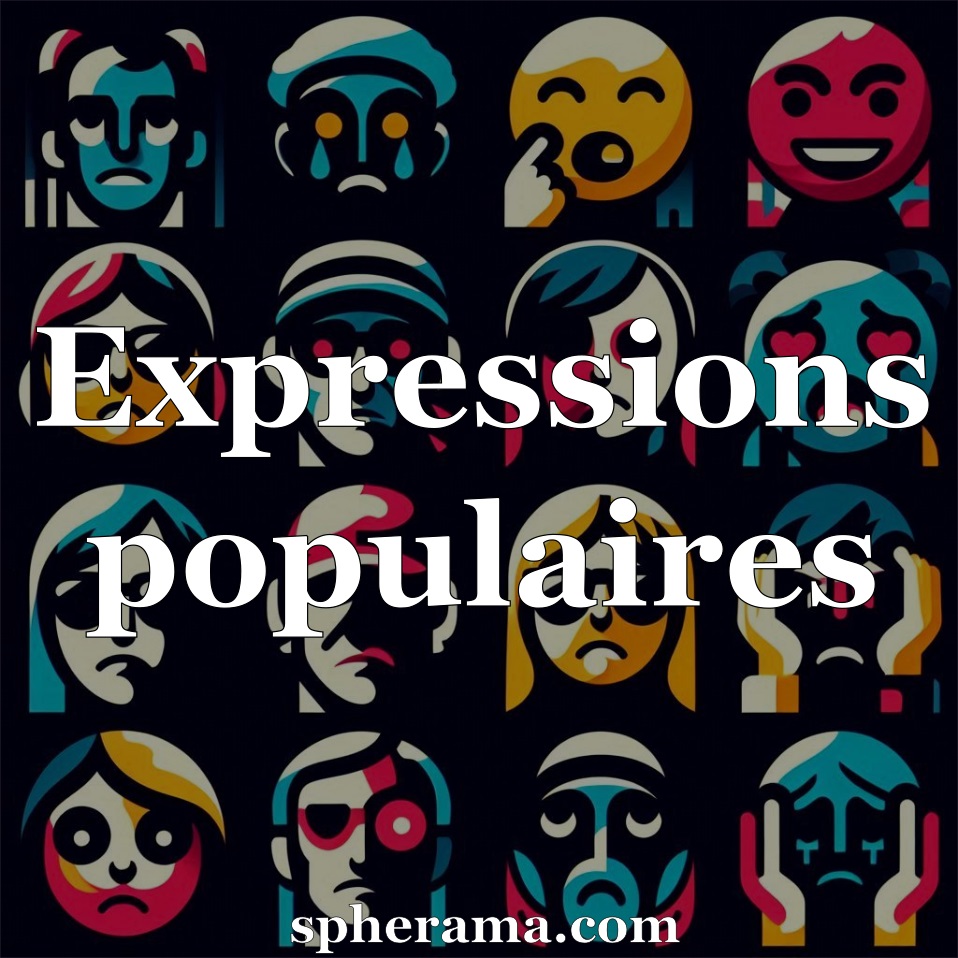Explorez les expressions populaires avec des articles détaillant leur définition, signification, origine et étymologie.
Lire plusExpression : c’est la Bérézina (définition, signification, origine, étymologie)
Définition et signification de l'expression c’est la Bérézina
- Désigne une défaite totale, marquée par l'effondrement d'une stratégie ou d'une organisation.
- Fait référence à une situation critique, particulièrement éprouvante ou chaotique.
L’expression « c’est la Bérézina » est utilisée dans le langage courant pour désigner un échec total ou une débâcle irrémédiable. Elle évoque une situation désastreuse, marquée par un sentiment d’impuissance ou de perte de contrôle, notamment lorsqu’aucune issue favorable ne semble envisageable. L’usage de cette formule véhicule généralement une forte connotation dramatique, soulignant l’intensité de la défaite ou du désastre, qu’il soit personnel, collectif, militaire, économique ou politique.
Par extension, la locution peut s’appliquer à tout contexte dans lequel une entreprise, une action ou un projet se solde par un revers majeur, souvent inattendu et irréversible. Elle s’emploie parfois sur un ton ironique ou emphatique dans des situations moins graves, mais néanmoins perçues comme chaotiques ou accablantes.
Origine et étymologie de l'expression c’est la Bérézina
L’origine de cette expression remonte à un épisode tragique de l’histoire napoléonienne : la retraite de Russie en 1812. Après une campagne militaire désastreuse, les troupes de Napoléon Ier, harassées par le froid, la faim et les attaques incessantes de l’armée russe, se retrouvent à la fin du mois de novembre devant la rivière Bérézina, en actuelle Biélorussie. Cette rivière large d’une centaine de mètres, profonde de deux à trois mètres, charrie alors des blocs de glace dans une eau glaciale. La traversée à la nage étant impossible, l’Empereur fait appel à ses pontonniers pour construire en urgence deux ponts de fortune.
Malgré les conditions extrêmes — températures descendant jusqu’à -30°C, fleuve en crue, pression ennemie constante — les hommes du général Jean-Baptiste Eblé réussissent à ériger les ponts. Environ 40 000 soldats parviennent à franchir la Bérézina, mais près de 30 000 hommes restent coincés sur l’autre rive, soit parce qu’ils n’ont pas eu le temps de passer, soit parce que les ponts ont été détruits pour empêcher les Russes de les suivre. Ce passage, pourtant considéré comme un exploit militaire, reste dans la mémoire collective comme le symbole d’un effondrement dramatique.
L’événement est dès lors associé à une vision d’horreur et de chaos, et le nom même de la Bérézina devient synonyme de catastrophe absolue. L'expression « c’est la Bérézina » apparaît dans la langue française dès la seconde moitié du XIXᵉ siècle, consolidant ce lien entre toponyme historique et débâcle totale.
3) Usage contemporain et extension du sens de l'expression c’est la Bérézina
Aujourd’hui, cette formule est largement employée de manière figurée pour qualifier des situations critiques ou des échecs retentissants. Elle peut concerner aussi bien la sphère privée (par exemple : « ce déménagement, c’était la Bérézina ») que des domaines plus institutionnels ou collectifs, tels que les défaites sportives (« la Bérézina des Bleus en coupe du monde »), les crises politiques ou les effondrements économiques.
Son usage, souvent chargé d’ironie ou d’exagération, n’en demeure pas moins révélateur d’un imaginaire collectif où certaines défaites historiques deviennent des repères linguistiques. Ainsi, dire c’est la Bérézina revient à mobiliser, consciemment ou non, une mémoire tragique et militaire pour décrire une situation contemporaine d’échec ou de chaos perçu comme irrémédiable.